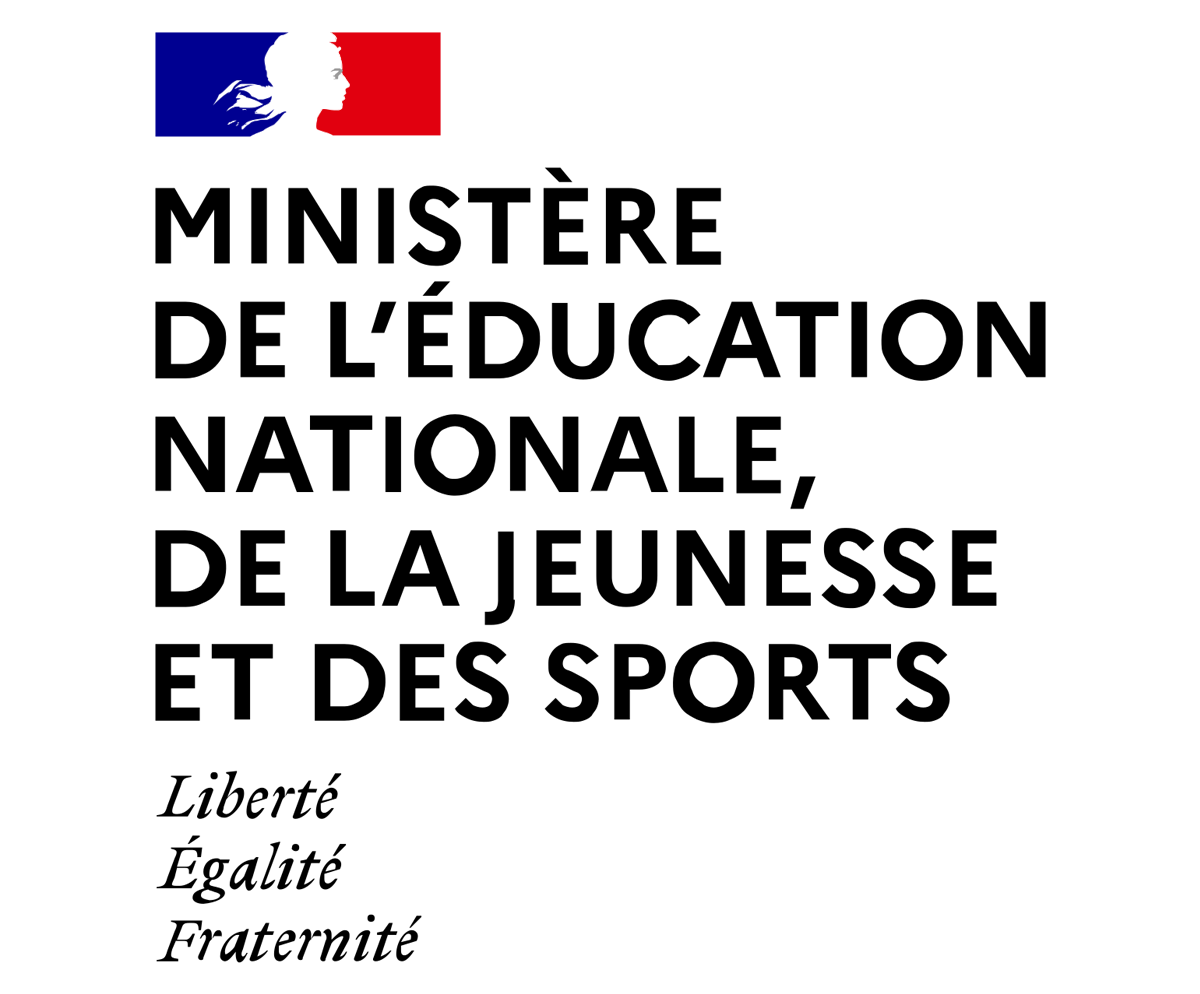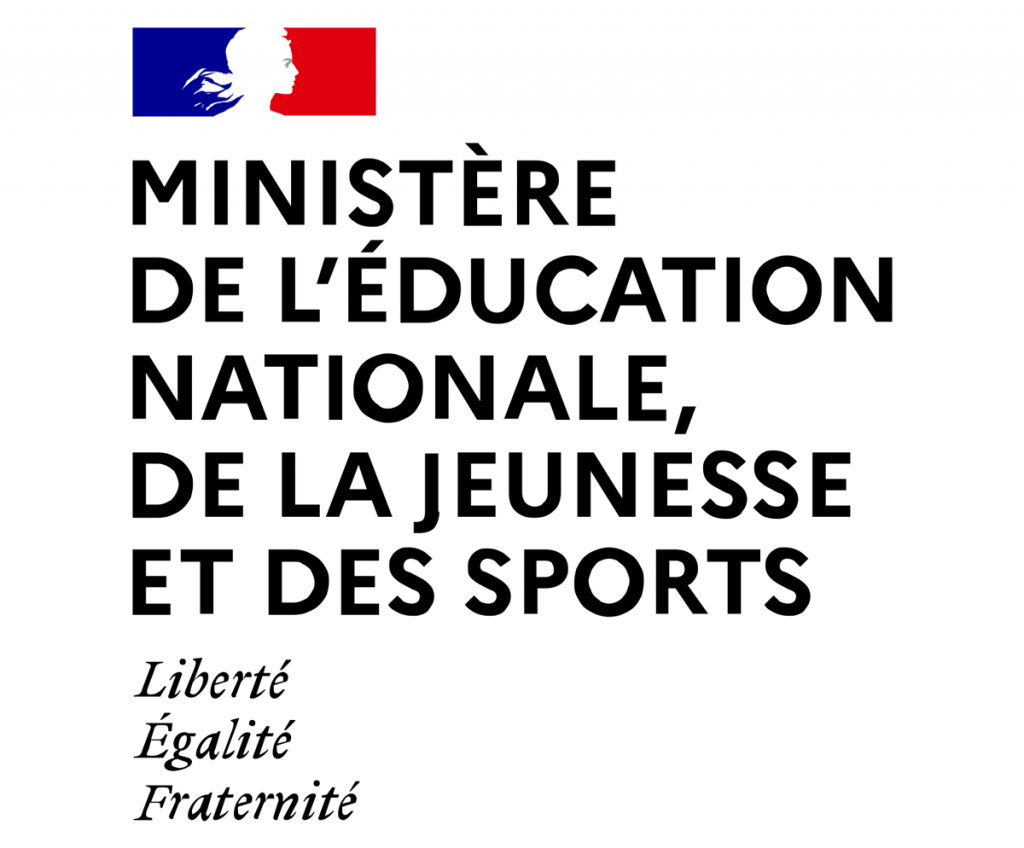Et si on osait dire qu’on ne sait pas ce qu’on veut faire à 18 ans ?
Chaque année, des milliers de jeunes traversent un moment d’angoisse intense : celui du choix post-bac. Selon une étude récente, près de 7 lycéens sur 10 déclarent ressentir un stress important lié à Parcoursup et à l’orientation. À 18 ans, ils doivent décider d’une voie qui paraît souvent définitive, sous le poids des attentes familiales, scolaires et sociales. Mais derrière ces chiffres, il y a aussi un malaise plus profond, plus silencieux. Une jeune fille accueillie récemment à l’Année lumière me confiait : « Je ne sais pas ce que je veux faire, et j’ai l’impression que je suis nulle. »
Et si, au fond, le problème n’était pas tant cette indécision, mais notre incapacité collective à la reconnaître et à l’accueillir ? Oser dire haut et fort qu’on ne sait pas ce qu’on veut faire à 18 ans, c’est peut-être le premier pas pour libérer cette génération de la pression paralysante qui l’étouffe.
L’illusion du choix éclairé à 18 ans
Nous vivons dans une société et un pays qui valorise la réussite rapide et linéaire. Très tôt, les jeunes sont soumis à une injonction forte : « Il faut savoir ce que tu veux faire. » Cette injonction s’accompagne d’une course effrénée au dossier parfait, entre notes, stages et activités extra-scolaires. Ce modèle véhicule une hiérarchie des parcours et l’obligation d’un choix quasi-immédiat, souvent présenté comme une évidence, sans laisser de place au doute ni au tâtonnement.
Mais choisir à 18 ans, est-ce vraiment faire un choix libre et éclairé ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une orientation forcée, dictée par un système scolaire rigide et des attentes sociales écrasantes ?
À ce propos, il est éclairant de regarder au-delà de nos frontières. Dans plusieurs pays nordiques, notamment au Danemark, les jeunes bénéficient d’un temps de pause, valorisé comme une étape normale. Ces années de césure (eh oui, les jeunes danois en font plusieurs !) ne sont pas perçues comme un retard, mais comme une phase essentielle d’exploration. Le modèle danois invite à reconsidérer la précocité de nos choix et à reconnaître la richesse du temps accordé au tâtonnement.
Ce que permet la fait de ne pas savoir tout de suite
Ne pas savoir ce que l’on veut faire à 18 ans, loin d’être un signe d’échec, est souvent le prélude nécessaire à un cheminement authentique. C’est un temps précieux d’exploration de soi, d’expérimentation et de rencontres. Loin des bancs de l’école, dans un cadre bienveillant comme celui que nous proposons à l’Année lumière, mais aussi lors d’une mission de service civique, d’un contrat de travail ou d’un voyage à l’étranger, les jeunes apprennent à prendre du recul, à se découvrir autrement, à s’autoriser à tâtonner sans peur du jugement.
Cette année de transition leur offre des outils pour développer leur autonomie, leur esprit critique et leur capacité à clarifier leurs désirs. Il ne s’agit pas d’une pause vide, mais d’une étape active, riche de sens, où le jeune construit les fondations de son parcours à venir. C’est souvent dans ce temps de latence que se dessinent des projets plus cohérents, plus en phase avec leurs valeurs profondes.
Plaidoyer pour une société qui valorise le tâtonnement
Nous devons cesser de voir le tâtonnement comme un retard ou une faiblesse. Le doute, le détour, l’essai-erreur sont au contraire des marqueurs de courage et d’intelligence. Ils témoignent d’une capacité à s’adapter, à apprendre, à grandir. Dans un monde en perpétuelle évolution, où certains métiers sont encore inconnus, cette capacité est précieuse.
Il est urgent que nos systèmes éducatifs, nos familles et nos institutions intègrent ces espaces de respiration, ces moments de flottement nécessaires. Offrons aux jeunes le droit de ne pas savoir, le droit de chercher, le droit de se tromper.
À 18 ans, on a surtout besoin d’air pour apprendre à respirer.
Cessons de presser cette génération comme un citron pour en extraire des réponses prématurées. Offrons-leur plutôt le cadre, la confiance et la liberté pour inventer leur voie, à leur rythme, avec la richesse du tâtonnement pour guide.